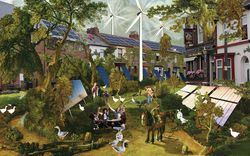Cartographie du paludisme en Italie
Texte par Andrea Bagnato
« Et on aurait pratiquement pu le toucher de ses mains, comme de la fumée s’élevant de la terre grasse, ici, partout […] stagnant dans la plaine comme la chaleur lourde de juin1 ».
— Giovanni Verga
Un des souvenirs les plus vivaces de mes étés d’enfance en Sardaigne est celui des rangées sans fin de grands eucalyptus pâles, et de leur présence quelque peu improbable parmi les arbustes méditerranéens. Mais encore plus étranges étaient ces mares d’eau putride et stagnante cachées derrière un grand nombre des plages splendides de l’île. Ce n’est que bien plus tard que j’ai appris à voir ce paysage comme le produit de siècles d’action humaine – et microbienne. Alors que j’avais auparavant considéré le paludisme comme une maladie des « Tropiques », j’ai découvert que la Sardaigne avait en fait enregistré les taux de mortalité due à celle-ci les plus élevés d’Europe occidentale jusqu’à ce que le XXe siècle soit bien entamé. Les « bizarreries » que j’avais observées dans l’environnement étaient le résultat d’un projet de longue haleine visant à éradiquer la maladie.
Depuis au moins l’époque romaine et jusqu’au milieu du XXe siècle, le paludisme a été endémique dans toute l’Europe et particulièrement meurtrier le long de la côte méditerranéenne. Les parasites du paludisme n’ont pas besoin d’une population hôte particulièrement dense pour survivre, parce qu’ils sont transmis par les moustiques anophèles, dont le rayon de vol s’étend sur plusieurs kilomètres. Et comme les anophèles se reproduisent dans l’eau stagnante, ils sont surtout présents dans les plaines fertiles, le long des côtes et autour des bassins fluviaux. Par conséquent, le paludisme est une maladie non urbaine, inter-reliée avec les conditions du paysage et l’organisation des habitations qui l’occupent. Contrairement à la plupart des épidémies urbaines de courte durée, le paludisme a une présence stable dans l’espace. Ce n’est pas une coïncidence si Fernand Braudel le considérait comme un acteur clé de la « longue durée » dans l’histoire méditerranéenne2.
Lire la suite