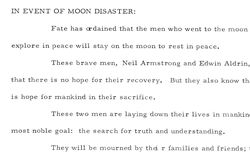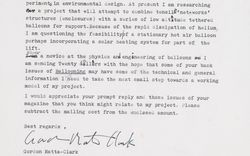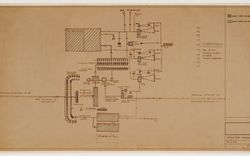Questions de conception détournée
Un projet curatorial de Francesco Garutti
Dans le film Misleading Innocence (tracing what a bridge can do) et la publication numérique qui l’accompagne, Can Design Be Devious?, Francesco Garutti, commissaire émergent au CCA en 2013-2014, explore l’histoire de la conception d’un ensemble de ponts autoroutiers à Long Island et les enjeux politiques qui y sont liés.
L’histoire suggère que ces ponts autoroutiers, commandés dans les années 1920 et 1930 par Robert Moses, aient été délibérément conçus pour empêcher le passage d’autobus de sorte que seules les voitures – et les personnes ayant les moyens de les posséder – puissent accéder aux espaces de loisir de Long Island. Cette histoire, bien que rejetée par les historiens de l’urbanisme américain, est souvent citée par les spécialistes qui étudient la question du contrôle par le biais de l’architecture ou des objets techniques et, de manière plus générale, celle de l’influence mutuelle entre la technologie, la politique et la société.
Quelle est la relation entre la politique et les artefacts, entre le pouvoir et la technologie? Dans quelle mesure et de quelle manière les intentions d’un projet donné peuvent-elles être délibérément occultées? Quels sont les effets insidieusement planifiés, et quelles sont les conséquences politiques imprévues de l’agentivité des artefacts qui nous entourent?
Les objets peuvent-ils êtres sournois?
Extraits d’une conversation entre Francesco Garutti, Stephen Graham et Albena Yaneva
Suivant l’avant-première du film Misleading Innocence au CCA en 2014, Francesco Garutti discute de l’histoire des ponts autoroutiers de Long Island et des politiques entourant les détours architecturaux, avec Stephen Graham et Albena Yaneva.
- FG
- Le sujet de Misleading Innocence est à la fois un débat scientifique et le fragment d’une recherche théorique qui, il y a trente ans de cela, ont changé notre regard sur les éléments constitutifs de la cité et sur les objets techniques avec lesquels nous vivons. Peut-être est-ce simplement un projet de recherche circonstanciel qui occupe l’espace ambigu entre l’histoire de la culture matérielle américaine et les rumeurs d’une légende urbaine. Le film a été conçu comme un outil muséologique visant à provoquer la discussion, à recueillir des points de vue différents et différentes lectures possibles des faits et de l’histoire.
- AY
- Il est intéressant que vous ne critiquiez pas explicitement l’idée de Winner1 selon laquelle Moses aurait volontairement conçu des ponts trop bas pour empêcher la circulation des autobus, mais que vous préfériez le voir comme un simple protagoniste dans ce débat. L’interprétation de Winner présente une dimension technologique pour le moins anémique, puisqu’il n’est question que de la hauteur du pont. Il y a dans le film un moment amusant, où l’on voit Winner se saisir d’un ruban à mesurer pour exprimer la hauteur du pont. Mais pourtant, il ne mentionne pas, entre autres, la matérialité, la forme, la construction, les innovations technologiques, les utilisateurs; pas plus d’ailleurs que les forces naturelles et la manière dont elles sont canalisées dans la forme spécifique d’un objet, le « pont bas ». D’un autre côté, Winner n’aborde qu’un seul type de politique : la discrimination raciale. Il réduit la dimension politique du concept de Moses en mettant la hauteur du pont et le racisme dans une sorte d’équation causale qui reproduit le clivage entre politique et technique.
Dans le film, le pont n’est ni simplement matériel, ni purement politique. Sa matérialité nous est présentée à travers une série de gros plans. Nous voyons ses différentes dimensions, la technologie à l’œuvre. Nous sommes témoins de l’utilisation de l’artefact, de ses défaillances et des réparations effectuées. Donc, nous sommes témoins de l’action d’un objet d’une grande complexité, qui ressort visuellement par la présentation de ses différentes dimensions et des nombreux acteurs qui gravitent autour de lui et l’entretiennent quotidiennement. Nous voyons se produire cet échec magnifique d’un artefact incapable de remplir la fonction qui est censée être la sienne, et avons ainsi une compréhension beaucoup plus complexe tant de la technologie que de la politique.
Francesco, vous présentez un artefact nettement plus hybride, parce que vous vous intéressez à ce qu’il fait, non simplement à ce qu’il est ou à ce qu’il signifie. Le message ici, c’est que si nous suivons le processus de conception ou les processus de contestation, d’utilisation quotidienne ou d’entretien, nous gagnons un accès privilégié à l’architecture et à l’infrastructure urbaine.
-
Langdon Winner a rapporté que Robert Moses avait conçu les ponts de Long Island trop bas à dessein pour limiter l’accès aux espaces de détente de l’île dans “Do Artifacts Have Politics?,” Daedalus 109, no. 1, Hiver 1980, p. 124; citant Robert Caro, The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York, New York, Knopf, 1974, p. 952. ↩
- SG
- Je pense que ce film est une évocation particulièrement puissante de certains des débats complexes entourant les villes et les infrastructures qui ont eu une influence certaine, mais uniquement dans une sphère plutôt restreinte des sciences sociales. Il est formidable de voir le sujet entrer dans le domaine du visuel, car il existe très peu de bons documentaires sur les infrastructures qui vont au-delà des clichés et donnent une interprétation nuancée des politiques entourant les artefacts technologiques qui peuplent le paysage infrastructurel. Il est important de souligner, en premier lieu, que nous sommes face à des objets politiques. Si l’on se replace à l’époque de Moses, il faut considérer ces objets dans le contexte des théories modernistes plus larges voulant qu’un individu donné puisse, de façon héroïque, remodeler un paysage urbain entier sur la base de certaines idées de progrès, de modernité et d’une vision de l’avenir. Le film intègre ces éléments avec élégance et nous montre les innombrables façons dont ils pénètrent les discours politiques, culturels et sociaux au travers des protagonistes, notamment des chercheurs en sciences sociales des technologies dont nous lisons les écrits depuis des années, et du pont lui-même.
Il existe de nombreux exemples de la planification et de la conception méthodiques d’infrastructures routières par des élites politiques pour mener de l’avant de vastes projets de génie civil entraînant la destruction délibérée de quartiers en particulier. Selon Marshall Berman1, ces projets avaient pour but de favoriser la minorité possédant une voiture et qui pourrait ainsi se mouvoir chaque jour à sa guise dans ces paysages. Il y a aussi de nombreuses autres questions d’équité urbaine au sujet des routes, et on pourrait en parler pendant des heures.
Lire la suite
- FG
- Je comprends ce que vous entendez par là. C’est pourquoi, dès le début de la recherche et de la réalisation du film, je me suis posé la question de ce qu’il fallait aborder de cette histoire qui comporte plusieurs niveaux et sous-thèmes, de l’histoire urbaine de New York au XXe siècle aux études sur les incidences inattendues de la conception d’objets et de technologies. J’ai été fasciné de découvrir à quel point le débat que je reconstituais était au cœur même des études en Sciences, Technologies et Société (STS), un domaine relativement nouveau.
- AY
- Le documentaire s’inspire de la tradition des STS établie dans les années 1970 avec les travaux de Bruno Latour et Steve Woolgar2. Leur démarche était celle de la « science en action » plutôt que celle d’une « science prête à penser » et se moulait au rythme quotidien d’un labo. Ils ont eu recours à l’observation ethnographique pour suivre la science en développement, afin de comprendre la production des faits scientifiques, la visualisation scientifique et les opérations matérielles qui accompagnent le travail scientifique3. Comme Steve l’a dit, nous avons grandi intellectuellement avec ce débat entre socio-constructivisme et théorie de l’acteur-réseau, entre contrôle et contingence. Avec le film, vous captez ce moment très particulier de controverses intenses entre érudits dans le domaine des STS au cours des années 1990, et vous vous en servez pour aborder les questions de technologie et de politique dans le champ de la recherche en architecture.
-
Marshall Berman, All that is solid melts into air: The experience of modernity , New York, Verso, p. 1983. ↩
-
Bruno Latour et Steve Woolgar, Laboratory life the construction of scientific facts, Princeton, N.J, Princeton University Press, 1979. ↩
-
Les travaux de Michael Lynch, Karin Knorr-Cetina, Bernward Joerges, Michel Callon, Madeleine Akrich et Peter Galison, entre autres, on mené à d’importants développements dans la pensée au sujet des pratiques de science, technologie et innovation dans les années 1990. ↩
- FG
- Il y a deux sujets dont je souhaiterais discuter avec vous. D’abord l’idée d’une controverse : le film est en soi un sujet de discorde , les ponts apparaissant comme des artéfacts contestés. Ensuite, la question de la défaillance et de l’échec.
- SG
- La question de l’accident est liée à l’infrastructure, qui est un terme défini socialement. Il existe de nombreuses technologies qui n’entrent pas dans la notion d’infrastructure. Selon l’anthropologie de l’infrastructure, une technologie, pour se muer en infrastructure, se doit de devenir invisible, ou du moins culturellement invisible. Évidemment, certaines infrastructures sont littéralement poussées dans une clandestinité souterraine, sous les villes, ou encore propagées à travers l’espace. La fonction normale de l’infrastructure dans nombre d’économies développées (le cas est différent dans les pays du Sud où la chose ne va pas nécessairement de soi) est d’assurer un flux régulier et ininterrompu, qui semble aller de soi. C’est ce que les sociologues appellent la boîte noire. Comme l’explique Bernward Joerges, les technologies entrent dans cette catégorie lorsqu’elles deviennent culturellement invisibles.
Les accidents sont des moments où ces dispositions ont une visibilité beaucoup plus grande, ironiquement et paradoxalement, car l’infrastructure ne fonctionne pas. La tempête de verglas de 1998 en Ontario et ici à Montréal en est un exemple1. Arcade Fire, un groupe local, a fait une chanson sur ce que représente vivre dans une ville industrielle moderne sans électricité pendant une longue période. Vous êtes dans le noir, vous avez froid, impossible de retirer de l’argent au guichet automatique… Les infrastructures sont tout d’un coup extrêmement visibles par leur défaillance. L’éruption volcanique en Islande est un autre exemple. Tout le système aérien mondial a été soudainement désorganisé. Vous pouviez voir, à la une des journaux, des coupes transversales de cinq types de réacteurs différents. À la minute où les avions ont recommencé à voler, ces schémas ont disparu. Même chose avec le désastre de Fukushima. Il est possible de contester les politiques technologiques avec beaucoup plus de poids lors de telles périodes de fortes perturbations. Cela est par contre beaucoup plus difficile quand les choses se replacent dans le substrat infrastructurel que la population tend simplement à prendre pour acquis. - FG
- Je crois que la liste établie par Latour des situations dans lesquelles il est possible de détecter la complexité cachée des infrastructures est tout à fait pertinente ici. Il parle de défaillances, d’échecs, de grèves, d’innovations et d’archéologie.
- SG
- Je suis d’accord. Et comment l’action politique a-t-elle le plus de pouvoir dans les villes d’aujourd’hui? Est-ce en investissant les rues, comme c’était typiquement le cas dans les périodes de révolution? Sans doute pas. Si vous voulez exercer un pouvoir coercitif sur l’économie tout entière, fermez l’aéroport! Il y a un bon exemple qui remonte à quelques années : une grève des employés chargés de l’approvisionnement en nourriture de l’aéroport d’Heathrow. C’est une organisation de travail gigantesque. Les employés sont souvent très mal payés et travaillent dans de très mauvaises conditions. Et c’est totalement invisible. Je ne pense pas que grand monde demande : « Qui produit ces repas abominables que je subis à chaque vol? » La grève a braqué les projecteurs sur cette réalité : une grosse entreprise du nom de Gate Gourmet, des migrants sans papier du monde entier et d’épouvantables conditions de travail. Cet exemple illustre avec éloquence la notion de vulnérabilité politique des sociétés infrastructurelles dans lesquelles nous vivons, dans des villes qui sont totalement dépendantes de toute une série d’infrastructures. Nous n’avons pas d’alternative à ces systèmes, et c’est ce qui les rend vulnérables.
- FG
- Une grève vide les bâtiments et fait sortir les gens dans les rues, ce qui montre que le bâtiment est en réalité un regroupement de corps. Albena, j’aimerais revenir à l’idée de la controverse qui est si centrale dans vos recherches, au croisement des études en STS et en architecture.
- AY
- La controverse en matière de conception dénote une incertitude partagée sur la nature même du design ou de la connaissance urbaine contestée; elle renvoie à la gamme des perplexités qui sous-tend tout projet urbain, et elle est synonyme d’« architecture en devenir ». Ces questions sont très liées au public de par leur complexité. La cartographie des controverses couvre un champ de recherche qui nous permet de décrire les étapes successives dans la production de la connaissance architecturale. Le film est un exemple éloquent de cette approche de cartographie des controverses, puisque vous dressez l’état des lieux du débat intellectuel des années 1990. Dans un sens, vous pensez comme un théoricien de l’acteur-réseau. Vous ne remettez pas en question l’essence de l’artefact. Vous ne posez pas la question de savoir si celui-ci est le reflet d’une politique ou pas, comme le fait Winner; vous choisissez plutôt de combler le vide entre politique et architecture. Pour ce faire, vous suivez autant d’acteurs que possible, vous écoutez patiemment ce que chacun d’eux a à dire, pas juste leurs interprétations et leurs histoires. Vous vous attardez aussi à leur position et à la multitude d’éléments et de problématiques qui constituent le pont autoroutier, ainsi qu’au large éventail de facteurs qui influent sur sa conception, son utilisation et son entretien. Cela nous aide à comprendre la nature architecturale des objets et la nature urbaine des réseaux et des artefacts, plutôt que de tenter de fournir une explication du point de vue de l’architecture. Le film nous entraîne dans l’univers de la controverse entourant le socio-constructivisme autant que dans celui du pont.
- FG
- En lisant l’essai de Winner, j’ai été immédiatement fasciné par l’idée d’occulter l’intention et par la facilité avec laquelle il est possible pour un concepteur ou un architecte de créer des artefacts ambigus ou tout simplement des artefacts avec une double fonction. C’est bien sûr cet aspect en particulier du texte de Winner qui amène le sujet du détournement. Pourriez-vous donner quelques exemples d’artefacts qui incarnent et définissent des politiques relatives au design et aux STS?
- SG
- Il y a beaucoup d’exemples. Le domaine des STS s’appuie sur des descriptions approfondies de certains cas : les portes et les clés, les bicyclettes. Il existe même un récit de l’histoire et de la conception des galions portugais, qui ont grandement contribué à l’entrée du Portugal sur la scène de le l’impérialisme maritime. Les téléphones en bakélite constituent un autre exemple. Il y en a bien d’autres : on trouve de nombreuses discussions de nature ethno-méthodologique très poussées. Puis, il y a tout le débat sur le cyborg; le débat sur la biotechnologie que Donna Haraway a largement contribué à lancer et alimenter. Elle aborde les discussions sur les politiques liées au genre en matière de fusion de la technologie et du corps, un sujet d’une grande importance. Il est toutefois difficile de trouver un exemple qui a donné lieu à des débats aussi denses que ces ponts…
- AY
- Il existe beaucoup d’autres exemples intéressants. La typologie de l’architecture parlementaire en est un. Jean-Philippe Heurtin, notamment, étudie les formes des parlements en France à l’époque de la Révolution. Il soutient que la forme des chambres de l’assemblée a une influence sur la manière dont sont menées les délibérations et sur la culture parlementaire en général. Il affirme en particulier que le processus fructueux des délibérations « politiques » dans les premiers parlements au moment de la Révolution française est conditionné de façon cognitive par l’aménagement spatial en hémicycle des chambres de l’assemblée. Dans le même ordre d’idées, nous pouvons dire que la forme de ce théâtre et la disposition de nos sièges jouent un rôle dans le déroulement de notre conversation. Ce que dit Latour dans le contexte de la tradition de médiation est utile ici. On ne peut affirmer que cette chaise, celle sur laquelle je suis assise, me force à m’asseoir d’une façon particulière qui détermine mon comportement. Mais les chaises, objets, technologies, aménagements matériels et architectures permettent la réalisation d’un certain nombre d’activités; elles améliorent les possibilités de fonctionnement, contribuent à la performance, arbitrent et facilitent les actions.
- FG
- C’est la définition du politique, n’est-ce pas?
- AY
- Exactement. C’est une façon détendue de parler de ce qu’accomplit la technologie, sans y incorporer le déterminisme architectural ou social.
-
Voir aussi Stephen Graham, dir., Disrupted cities: When infrastructure fails, New York, Routledge, 2010. ↩
- SG
- Comme Latour le mentionne dans le film, certains micro-éléments de l’environnement bâti peuvent facilement être interprétés comme étant politiques. Les bancs qui empêchent les gens de s’y allonger sont un exemple classique de ce que les géographes qualifient de politiques revanchardes, et constituent un cas d’embourgeoisement des espaces urbains avec comme perspective les besoins de l’élite et l’exclusion des populations marginalisées. Il ne s’agit pas d’un simple déterminisme technologique ou environnemental de cause à effet : le caractère intentionnel est assez évident.
- FG
- L’emploi que fait Bruno Latour du terme détourné m’intéresse. Il parle du détournement comme d’un effet non direct, quelque chose qui est envisagé comme indirect, mais qui, dans ce cas, a des implications morales. Et les implications morales sont presque impossibles à détecter et à vérifier. L’idée de détour est en ce sens liée à celle d’une conception sournoise. Pour les chercheurs en STS, le détour est le thème essentiel à explorer pour étudier les techniques et leurs écosystèmes et effets, plutôt que les implications morales découlant du détournement lui-même. Qu’en pensez-vous?
- AY
- Les détours sont importants, en effet. En matière de conception, d’utilisation, d’habitation ou d’entretien, on ne suit jamais une suite d’actions linéaire. C’est particulièrement vrai en architecture : un bâtiment n’est jamais totalement identique aux dessins ou plans initiaux. L’idée de détour est très différente de l’interprétation de Steve Woolgar. Woolgar s’intéresse uniquement au discours, ce qui implique que le pont n’évolue pas, et que seule l’interprétation qui en est faite change. Le film présente un point de vue assez différent : ici, le pont est un objet en évolution, qui est différent à chaque prise de vue. Il change en permanence, pas juste dans le discours, mais aussi d’un point de vue matériel et relationnel.
- SG
- Effectivement, beaucoup de choses doivent être refaites matériellement, sinon elles s’effondrent. Il y a une grave crise actuellement, en particulier en Amérique du Nord, parce que les infrastructures ne sont pas renouvelées. Il y a défaut d’investissement et d’entretien. On trouve des exemples très clairs où il y a manifestement intentionnalité, notamment, comme nous l’avons évoqué, les équipements hérissés de piques spécialement conçus pour éloigner les sans-abris. Mais même dans ce cas, il y a un ensemble de pratiques et de politiques qui rendent l’interprétation plus complexe.
Souvent, les architectes et concepteurs ne contrôlent pas la forme que prendra, en fin de compte, un projet. Et ils ne contrôlent évidemment pas l’entretien. Dans les villes du monde entier, combien de tours ont un ascenseur en panne? Toute notion de mode de vie moderne s’écroule à la minute où l’ascenseur tombe en panne. Par ailleurs, les architectes ne contrôlent pas non plus l’utilisation qui est faite de l’espace. Il y a souvent une plus grande flexibilité dans l’utilisation des espaces que ce qui était prévu initialement. - AY
- Si on regarde les concepteurs à l’œuvre, on s’aperçoit que le résultat final peut être totalement différent des plans d’origine. Il y a une intention bien précise (en général bonne), mais tellement de facteurs entrent en ligne de compte dans le processus de conception, tellement de détours surviennent, que le projet prend de nouvelles dimensions. On en a un exemple récent avec le Stata Center de Frank Gehry sur le campus du MIT. Il avait l’intention louable de concevoir un bâtiment exceptionnel pour les scientifiques, mais il ne les a jamais consultés. Et en fin de compte, ces scientifiques n’ont pas été satisfaits par l’espace livré. Ils ont dit : « C’est un bel espace incurvé, mais on s’y sent comme des rats ». L’intention de l’architecte était bonne. Mais du point de vue des utilisateurs, la conception pouvait être perçue comme « détournée », selon les termes de Francesco, le résultat étant une expérience négative de l’espace.
Cette conversation est parue, en anglais, dans notre publication numérique Can Design Be Devious? (CCA, 2015).
« Misleading Innocence (tracing what a bridge can do) »





Le film Misleading Innoncence (2014), conçu par Francesco Garutti et dirigé par Shahab Mihandoust, explore l’histoire des promenades autoroutière de Long Island et les politiques entourant leur conception, au moyen d’entrevues avec quatre spécialistes qui, dans les années 1980 et 1990, ont débattu des interprétations possibles du cas : Bernward Joerges, Bruno Latour, Langdon Winner et Steve Woolgar. Le film évoque plutôt qu’il n’explique; il entremêle le reportage et l’abstraction théorique, il combine le bruit assourdissant des voitures au chant des oiseaux autour des promenades de Long Island, aujourd’hui presque centenaires.
Ce film a été mis à disposition dans son entier le 31 août 2020. Voir ici pour plus d’informations sur ce projet.