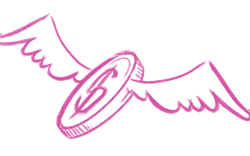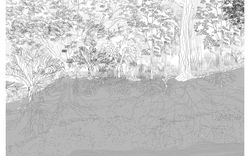Les contre-récits du care
Michaela Prunotto en conversation avec Loving Country. Photographies de Vicky Shukuroglou.
« Lors de cet incendie (j’y ai pensé aujourd’hui parce que je me suis retrouvé sur cette route), certaines parties [de la route] portent encore les traces des arbres tombés au sol puisque le bitume était en feu. C’est du jamais vu. C’était un feu d’une chaleur incroyable ».1
-
Dans mon entretien avec Pascoe et Shukuroglou, j’ai abordé une question générale sur fond de feux de brousse, de résilience écologique, du brûlage culturel et de conception pour le Country : cette question est la suivante : « Comment le pouvoir de la “présence” façonne-t-il l’architecture et l’aménagement de l’espace aujourd’hui? ». Voir Bruce Pascoe, dans Bruce Pascoe et Vicky Shukuroglou, interview par Michaela Prunotto, « MTalks – Igniting Presence – a Forum on Inflection Vol.8 », MPavilion, publié le 14 décembre 2021, https://mpavilion.org/program/igniting-presence-a-forum-on-inflection-vol-08/. ↩
Au cours d’une discussion avec l’écrivain yuin, bunurong et tasmanien Bruce Pascoe en décembre 2021, il me décrivait une infrastructure coloniale (« le bitume »), pétrifiée avec les traces d’un écosystème autochtone calciné lors des feux de brousse de « l’été noir » en 2019-2020. Il affirmait que l’écologie des feux de brousse de la ville australienne de Mallacoota a été perturbée – enflammée à des températures « sans précédent » – par l’industrie coloniale de l’exploitation forestière. Ses remarques, animées par un langage de collision et de contact, témoignent de la violence des récits coloniaux qui ont façonné l’environnement bâti australien, face auxquels Pascoe formule des contre-récits.
En Australie, les manifestations coloniales de la dépossession sont manifestes dans presque tous les éléments de l’environnement bâti, qu’il s’agisse des routes en bitume, des immeubles d’habitation à ossature métallique ou des pylônes électriques en treillis. Ces structures matérielles alimentent à leur tour les récits coloniaux, à savoir des narrations qui camouflent les ravages permanents de la colonisation sous un vernis grandiloquent au nom du « progrès ». Mon intention ici est donc de m’éloigner de la discussion directe avec les récits coloniaux transmis par les colons, en évitant la consolidation à travers la critique. Il semble au contraire plus constructif de proposer une plateforme pour les expressions du contre-récit. Alors que les récits coloniaux hégémoniques sont souvent liés à des structures à croissance rapide et motivées par le profit, le contre-récit émane d’un terrain plus omniprésent et sacré : les conceptions des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres liées au « Country », terres du pays des peuples aborigènes.
Étant donné qu’en Australie, la documentation sur l’appropriation et l’aménagement de l’espace précolonial reste fragmentaire, que les droits fonciers des « Traditional Owner » (propriétaires traditionnel·les) sont fréquemment contestés et que les communautés autochtones australiennes manquent souvent de ressources, les contre-récits du Country constituent un outil important pour l’aménagement d’espaces tangibles et intangibles comme lieux de résistance1. Le terme « contre » est utilisé dans les sciences sociales pour décrire un espace de résistance opposé aux forces hégémoniques. Les contre-récits, quant à eux, font référence aux histoires issues des paroles des personnes historiquement marginalisées. En puisant parmi des milliers d’années de contes oraux, de lignes de chansons et de pratiques de la narration comme méthodes de transfert des connaissances, lorsque les voix des Premières nations sont amplifiées par les vecteurs contemporains du journalisme postcolonial et du discours universitaire progressiste, les contre-récits liés au Country peuvent être popularisés. Malheureusement, face à un gouvernement de droite et à ses partisan·es, ces mêmes contre-récits peuvent aussi être source de divisions.
Bruce Pascoe, auteur du controversé et déroutant Dark Emu (2014)2 – a été qualifié de manière frappante par le journaliste Kerry O’Brien de « paratonnerre » (lightning rod) pour le clivage des récits sur l’histoire pré et post-coloniale de l’Australie et le rôle que le racisme y joue3. En réfléchissant à un entretien que j’ai réalisé avec Bruce Pascoe et Vicky Shukuroglou, co-auteur·rices de Loving Country: A Guide to Sacred Australia (2020), je me suis intéressée au rôle de leurs contre-récits collaboratifs pour comprendre la place et présence du Country au sein de l’Australie coloniale, en mettant l’accent sur le dialogue profond, la pratique du care au-delà de l’humain et la tradition du brûlage culturel.
-
Alexandra Pereira-Edwards, « Counter-Infrastructures: Place-making as Resistance », Inflection 8, Michaela Prunotto, Kate Donaldson and Manning McBride (dirs.), Melbourne Books, Melbourne, 2021, 8-13. ↩
-
Dans le discours académique, l’anthropologue et linguiste Peter Sutton et l’archéologue Keryn Walshe ont écrit un livre qui formule une critique approfondie du livre de Pascoe, Dark Emu. Leur livre s’intitule Farmers or Hunter-Gatherers? The Dark Emu Debate. Il est important de noter que Pascoe se définit avant tout comme un auteur de fiction, de poésie et de non-fiction, plutôt que comme un universitaire. Il a également fait l’objet d’attaques personnelles remettant en cause son héritage australien autochtone de la part de personnalités politiques et médiatiques d’extrême droite. ↩
-
Bruce Pascoe, entretien réalisé par Kerry O’Brien, « A better future for all: Kerry O’Brien in conversation with Bruce Pascoe », publié le 12 octobre 2020, https://www.youtube.com/watch?v=qX_1z1qNoa8. ↩
Un dialogue profond
« Est-ce que je parle au nom d’une autre personne? Si oui, en est-elle consciente? Ai-je sa permission de communiquer ces informations? Si c’est le cas, suis-je bien restée dans le cadre des permissions qui m’ont été accordées ou est-ce que je suis en train de déformer leur voix en spéculant sur un sujet dont je ne connais qu’un aspect particulier? »1
-
Sarah Lynn Rees, « Blakitecture: Beyond acknowledgement and into action », Architecture Australia 109, no. 2, 2020, 66. ↩
Sarah Lynn Rees, une femme palawa descendante des peuples plangermaireener et trawlwoolway du nord-est de la Tasmanie, préconise ce type de questionnement itératif lorsqu’elle aborde des processus de décolonisation ou d’autochtonisation liés à un contexte architectural. La sensibilité et la capacité d’autoréflexion semblent être essentielles à une action constructive et positive de la part des personnes australiennes non autochtones. Cela ne veut pas dire que le questionnement doit s’effilocher jusqu’à l’effacement ; Jefa Greenaway, homme et chercheur wailwan/kamilaroi, a observé la tendance des facultés d’architecture universitaires non autochtones à marcher sur des « œufs culturels », autrement dit, à « l’inaction par peur de faire une erreur »1. La « paralysie morale » qui apparaît lorsque les personnes blanches se soustraient aux domaines de l’engagement interculturel – c’est-à-dire lorsqu’elles ont la possibilité de choisir les questions à aborder en matière d’histoire de l’architecture – est un exemple éloquent du privilège blanc2. Bien que mon texte soit motivé par une critique de l’inertie blanche, il est néanmoins important de préciser l’identité de l’auteur et ses limites. En tant que personne blanche, immigrée en Australie depuis la première génération et ayant des origines italiennes, je note ma naïveté, mais aussi ma volonté de changement social lorsqu’il s’agit de questions politiques liées aux peuples des Premières nations dans le discours architectural australien et au-delà. À travers cet écrit sur les contre-récits spatialisés, ma capacité à écouter attentivement les histoires des autres est enrichie et, à son tour, peut, je l’espère, générer un dialogue supplémentaire en vue d’une plus grande empathie collective.
Le modus operandi de Sarah Lynn Rees, qui consiste à réitérer des questionnements – par opposition au monologue – a été adopté lors de mon entretien virtuel avec Bruce Pascoe et Vicky Shukuroglou, qui s’est tenu en décembre 2021, au cours duquel j’ai posé de courtes questions (sur la résilience écologique, sur comment concevoir pour et avec le Country, sur le brûlage culturel) à mes interlocuteur·rices de manière à rester en retrait. Il s’en est suivi le partage d’histoires sincères et merveilleusement complexes racontées par Pascoe et Shukuroglou.
L’une des caractéristiques importantes du format de l’entretien est qu’il peut susciter ou développer, un dialogue profond. L’ethnographe Deborah Bird Rose préconise l’ouverture, et donc l’imprévisibilité, lorsqu’il s’agit de mettre en place les bases d’un dialogue éthique. Puisque l’ouverture entraîne la réflexivité, notre propre position (dans ce cas, celle de l’intervieweuse) est déstabilisée et peut être surprise, remise en question et transformée3.
Malheureusement, au-delà du discours architectural et auprès du grand public australien blanc, il reste toujours des personnes qui piétinent agressivement les « œufs culturels » dialogiques de Greenaway et d’autres qui les évitent complètement en restant résolument fermées et monologiques. Cela nous amène à la puissance de l’œuvre de Pascoe, c’est-à-dire aux contre-récits qui ont touché la conscience collective australienne par leur capacité à ébranler le monologue colonial des autorités colonisatrices et à susciter un dialogue hautement médiatisé, quoique parfois éprouvant. L’intentionnalité de cette approche courageuse a été exprimée avec insistance par Pascoe lors de notre entretien : « Nous devons parler à des personnes dont nous savons qu’elles ne partageront pas notre point de vue. Je pense que c’est essentiel »4.
Malgré sa volonté de se confronter à des conversations épineuses, Pascoe collabore également avec des personnes partageant les mêmes idées, à l’instar de Shukuroglou. En tant qu’Australienne non autochtone dont les ancêtres témoignent néanmoins d’une histoire de dépossession, Shukuroglou adopte une éthique du care dialogique dans sa compréhension et son amour pour le Country. Dans Loving Country, elle écrit dans l’introduction au sujet des membres des Premières nations qui ont façonné le livre de manière verbale et informelle : « Dans chaque communauté, les personnes étaient ouvertes à la discussion et appréciaient d’être entendues. Elles souhaitent que leurs histoires soient racontées, que le Country soit mieux compris et aimé… Chaque personne est porteuse de sa propre histoire »5. De cette manière, Shukuroglou joue un rôle de bricoleuse de contre-récits en assemblant, interprétant et transportant les histoires des autres vers un public plus large à travers sa propre voix empathique.
-
Jefa Greenaway dans « Decolonising Architectural Education », une table ronde organisée dans le cadre de la Melbourne Design Week et animée par Rochus Hinkel et Peter Raisbeck, 25 mars 2022, https://www.youtube.com/watch?v=KhY3hbMSW8Q. ↩
-
Nancy L. Nelson citée in Kelly Greenop, « Taking my place / talking your place: race, research and indigenous architectural history », dans Speaking of Buildings: Oral History in Architectural Research, Janina Gosseye, Naomi Stead, et Deborah van der Plaat (dirs.), Die Keure, Belgique, 2013, 155-56. ↩
-
Deborah Bird Rose, « Indigenous ecologies and an ethic of connection », dans Global Ethics and Environment, Nicholas Lowe (dir.), Routledge, Londres, New York, 1999, 175. ↩
-
Pascoe, entretien par Prunotto, « MTalks – Igniting Presence », 2021. ↩
-
Vicky Shukuroglou, « Introduction », dans Bruce Pascoe et Vicky Shukuroglou, Loving Country: a guide to sacred Australia, Hardie Grant, Melbourne, 2020, ix. ↩
Représenter le Country
« Si nous pensons au Country de manière holistique, ce n’est pas seulement la terre, le ciel, la mer, c’est toute chose et tout système qui évolue dans cet espace, à la fois matériel et immatériel, dont chaque aspect existe dans l’équité. »1
-
Sarah Lynn Rees, citée dans N’arweet Carolyn Briggs AM, Sarah Lynn Rees en conversation avec Max Delany, « Ngargee Djeembana: On the materiality of public space and Country », Artlink 41, no. 2, 2021, 14. ↩
Cette citation, également de Sarah Lynn Rees, énonce un contre récit puissant pour décrire le Country. Dans un contexte australien colonial, nous pouvons conceptualiser les contre-récits comme des voies autodéterminées par lesquelles les propriétaires traditionnels cartographient leurs propres conceptions de l’espace. Au fur et à mesure que les perspectives complexes des individus sont formulées, l’agencement (légèrement territorial) de l’espace se manifeste à travers les mécanismes du langage. Il est important de remarquer que les descriptions du Country aux personnes australiennes non autochtones reposent inévitablement sur des processus de traduction linguistique, un phénomène qui évolue sur plusieurs générations ou immédiatement. La nature limitative de cette traduction est parfaitement résumée par Bua Benjamin Mabo, un linguiste meriam, qui observe que « Keriba gesep agiakar dikwarda keriba mir ; C’est la terre qui a donné naissance à notre langue »1. Ici, la langue et la terre apparaissent comme inextricablement liées.
-
AIATSIS, « Living Languages », https://aiatsis.gov.au/explore/living-languages. ↩
Une pratique et une politique du care au-delà de l’humain
« Elle pensa à l’échidné étreignant le sol, aux résidus de terre qui parsemaient ses yeux, incrustaient ses narines humides et parfumaient distinctement son corps. La perspective de l’échidné est d’un autre monde que le sien – ses horizons sont variés – son architecture est imprégnée de la subtilité de ce lieu. »1
-
Vicky Shukuroglou et Bruce Pascoe, « WHOSE ARCHITECTURE », Inflection 8, Michaela Prunotto, Kate Donaldson et Manning McBride (dirs.), Melbourne Books, 2021, 30-33. ↩
L’entretien que j’ai réalisé avec Pascoe et Shukuroglou fait suite à leur contribution pour Inflection Journal Vol. 08, une revue gérée par des étudiant·es de la Melbourne School of Design. Leur histoire publiée dans Inflection, intitulée « Whose Architecture », est divisée en deux récits de vulnérabilité non humaine : la première moitié suit un échidné aux piquants cassés et la seconde nous présente « un dingo blessé »1. Un changement de lieu, de pronom et de voix de l’auteur intervient à mi-parcours, ce qui, selon les deux auteur·rices, est un dispositif de désorientation intentionnel et important. Lors de notre entretien, Shukuroglou a poursuivi en précisant que « la dislocation, l’incertitude, l’interrogation participent de la manière dont j’aime aborder l’écriture… la dislocation est très présente sur cette terre »2.
Pascoe et Shukuroglou abordent l’écriture du paysage et du non-humain d’une manière délicieusement détaillée, mais aussi holistique et interconnectée. Cette démarche est représentative d’une éthique écologique plus large appliquée dans leur vie quotidienne ; Pascoe avec son Black Duck Foods (une entreprise sociale et agricole), et Shukuroglou avec son groupe d’activistes pour la biodiversité Nillumbio (basé dans le comté de Nillumbik). Tant leurs actions sensibles que leurs récits littéraires nourrissent le Country en tant qu’écosystème délicat en équilibre qui demande respect et sollicitude. Dans Loving Country, ce contre-récit du care perdure sous la forme d’un guide qui propose une autre façon de voyager et de comprendre l’Australie à travers les récits autochtones, avec l’intention plus large de « favoriser la communication et la compréhension entre tous les peuples et le Country »3. En situant chaque chapitre du livre dans des lieux culturellement significatifs – le premier s’intitule « Gulaga & Biamanga », le second « Namadgi », etc. –, Love Country facilite les interactions directes avec des lieux tangibles à travers un dialogue tissé dans le temps. Le contre-récit du care développé par Pascoe et Shukuroglou s’aligne sur la description faite par Lynn Rees du Country comme un système harmonieux dont chaque aspect « existe dans l’équité ». En effet, le Country est un terrain où le territoire, la mer, la terre et le ciel se rassemblent non pas comme des ressources à contester, mais comme un « espace vital »4.
À un moment de notre entretien, Shukuroglou a évoqué une image, celle d’une toile d’araignée constellée de gouttes de rosée, tissée autour d’un fil barbelé, dont la soie a capturé des graines d’herbe indigène du panicum, une source de nourriture importante pour les peuples autochtones de nombreuses régions du pays depuis des milliers d’années5. Bien que le matériau contraignant et agressif du fil barbelé évoque l’agriculture coloniale et la consommation anthropocentrique de viande, dans la même conversation, Pascoe s’émerveille de « tous les petits mondes, ce cosmos de vie, qui peuplent la clôture en fil barbelé ». Il nous invite : « Si vous regardez bien, vous pouvez voir sur l’une des perles au milieu, la tension en surface qui rejoint la toile [d’araignée] ». Là où les barbelés territoriaux s’affirment, un cosmos du Country prévaut par l’observation attentive et l’articulation poétique. La microarchitecture d’une araignée et les graines de panicum éveillent dans notre conscience un Country plein d’humanité, mais aussi, bien au-delà de l’humain.
-
Sukuroglou et Pascoe, « WHOSE ARCHITECTURE », 30-33. ↩
-
Shukuroglou, entretien par Prunotto, « MTalks – Igniting Presence », 2021. ↩
-
Pascoe et Shukuroglou, Loving Country. ↩
-
Libby Porter, « From an urban country to urban Country: confronting the cult of denial in Australian cities », Australian Geographer 49, no. 2, 2018, 244 ↩
-
Porter, « From an urban country to urban Country », 244. ↩
La tradition du brûlage culturel
« Les gens qui travaillent à la ferme suivent les traditions yuin. Et le feu en fait partie. Donc, tous les mois, toutes les semaines en ce moment, nous le pratiquons. Les Australien·nes peuvent se rassurer : les peuples aborigènes pratiquent toujours les anciennes traditions. Il y a des choses que nous ignorons et que nous aimerions savoir, mais nous devons nous concentrer sur ce que l’on sait déjà. C’est un savoir acquis, parce qu’un vieil homme, une vieille dame nous a raconté que les choses fonctionnaient ainsi autrefois… On sourit et on pleure à la fois en regardant des films où l’on peut voir des vieilles personnes qui brûlent et marchent à travers (le feu) pieds nus. »1
-
Pascoe, entretien par Prunotto, « MTalks – Igniting Presence », 2021. ↩
L’un des aspects les plus émouvants de l’entretien avec Pascoe et Shukuroglou a sans doute été leur discussion sur le feu. Pascoe évoque sa proximité avec les feux de brousse de l’été noir de 2019-20, qui – comme le traduit sa citation d’introduction à cet essai – ont été « d’une chaleur incroyable » et d’une destruction effrayante. Cependant, les co-auteur·rices ont également évoqué leur participation à des brûlages culturels, définis par le chercheur wiradjuri Michael-Shawn Fletcher comme l’utilisation par les Premières nations australiennes de feux de faible intensité destinés à éliminer l’accumulation de combustibles légers tels que les feuilles, les brindilles ou les herbes sèches pour favoriser la nouvelle croissance. Il s’agit d’une pratique « intime et réfléchie par rapport aux contextes locaux », exécutée pour toute une série de raisons : spirituelles et rituelles, pragmatiques et économiques1.
À propos de ces brûlages culturels, Pascoe explique : « On dit toujours ici que si l’on ne peut pas traverser le feu avec une paire de Blundstones, c’est qu’il est trop chaud… Si on peut y arriver, alors l’animal le peut aussi. Et nous brûlons pour cet animal »2. Par le transfert oral des connaissances, Pascoe exprime à nouveau le souci critique d’une écologie entrelacée entre les personnes, les animaux et le paysage. En outre, ce processus de transmission d’histoires et de coexistence avec le non-humain est un phénomène profondément spatio-temporel. Tout comme « Whose Architecture » explore « l’idée que nous partageons nos habitats – d’une génération à l’autre, d’une bête à l’autre », il existe également un transfert de connaissances et de contre-récits qui se produit à travers l’espace et le temps entre les générations.3
Des territoires résilients
Lorsque l’on comprend la contribution irrévocable et positive de Bruce Pascoe dans la transmission de contre-récits sur le Country – par le biais d’une écriture prolifique et populaire, d’un activisme de terrain et d’une volonté de dialogue – la critique envers ses histoires (souvent blanche, académique ou d’extrême droite) devient un peu moins pertinente. Malgré certains détails dans ses textes non fictionnels qui ont suscité des discussions passionnées et plus mitigées, il est évident que Pascoe reste sans équivoque engagé à faciliter un changement social et écologique positif. La résilience devient une incarnation importante de Pascoe et des contre-récits ; l’individu doté d’une voix défie l’adversité et le traumatisme intergénérationnel pour forger un espace productif de résistance contre l’oppression coloniale. Fondamentalement, les contre-récits du care proposés par Pascoe et Shukuroglou se caractérisent par une politique du care généreuse et critique, et s’efforcent de transmettre un dialogue spatialisé (et positif) qui s’adapte et évolue en Australie pour les générations à venir.
Cet article a été traduit de l’anglais par Gauthier Lesturgie.