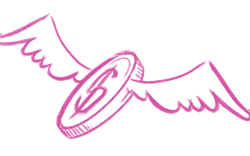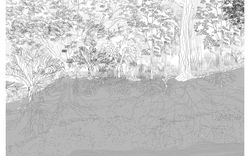Hong Kong / l’ouverture de l’espace et le film à plan fixe
Sony Devabhaktuni analyse l’image stillmoving
Alors qu’Hong Kong traverse une période où l’avenir s’impose comme un champ d’action statique et cloisonné, le film à plan fixe, en tant qu’expérience de la ville, est attentif à la contingence du présent. Il invite à se mettre au diapason de l’incertitude du devenir, où le doute et la remise en question apparaissent comme les qualités nécessaires d’un futur encore tenu pour potentiel.
Mercredi 14 mars 2018, heure de départ 18h30, de Bowen Trail
L’hippodrome du Jockey Club un mercredi sans courses. La lumière de Times Square se disperse parmi l’amas d’immeubles en demi-fond. Deux télévisions dans des appartements adjacents diffusent la même émission du soir. Des faucons tournent en rond au gré des courants, scrutant les arbres. La circulation en provenance de South Island ralentit le long du pont qui sépare Wan Chai de Causeway Bay. Sur Bowen Trail, les coureurs foulent le sol d’un pas lourd. Leur respiration et les conversations des personnes qui passent se font entendre, puis s’évanouissent au milieu du vrombissement des insectes.
Le cinéma figure l’espace en déplaçant les images au fil du temps. Dans les films qui prennent la ville pour sujet, ce déplacement peut prendre la forme d’une série de coupes rapides ou bien s’effectuer à des vitesses qui tracent une continuité sinueuse. Les deux manières de représenter la ville (en staccato ou en continu) occultent l’image elle-même, laissant la sensibilité effective s’installer. Je pense, par exemple, à Koyaanisqatsi: Life Out of Balance (1982) de Godfrey Reggio ou aux observations plus récentes de Jessica Kingdon sur la Chine contemporaine dans Ascension (2021). Ces films sollicitent une certaine manière de regarder qui dépend moins d’un regard sensible que d’un abasourdissement qui rend l’image elle-même conciliante.
À la différence des entrecroisements que ces œuvres proposent, le film à plan fixe présente une ouverture singulière et stable sur le territoire. Proche de la photographie par son immobilité, l’image statique du plan fixe appelle une attention à la surface : une sensibilité pour les changements qui s’y produisent. L’accumulation de ces variations et l’extension de l’image dans le temps ouvrent sur un devenir.
Comme l’a noté la spécialiste des médias Catherine Fowler, le plan fixe nous ramène aux origines du cinéma, lorsque des techniciens et techniciennes qui manipulaient des caméras encombrantes filmaient les « réalités » de gens ordinaires effectuant des tâches quotidiennes1. La capacité de retranscrire le monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a d’abord été en soi tout à fait stupéfiante. Mais très vite, les scènes quotidiennes ont été dépassées par la contingence : non pas du terrible qui survient, mais plutôt du rien ne se passe. Pour combler ce vide, les cinéastes se sont tournés vers la narration. L’auteur s’assure que quelque chose se passe et prévient l’arrivée de l’ennui. Cela a donné naissance à un mode de visionnement habituel dans lequel l’événement et l’anticipation rythment le passage du temps.
Le film à plan fixe renverse cette attente contemporaine en offrant une « réalité » dans laquelle le contingent est un plan aplati où il ne se passe rien du tout. On le voit, par exemple, dans la célèbre prise de vue d’une durée de huit heures de l’Empire State Building par Andy Warhol. Arthur Danto décrit Empire (1964) comme une révélation du cinéma – un retour socratique aux essences – qui prouve que peu de choses dans une image animée nécessite de bouger pour être un film2. Ce qui a bougé, en revanche, c’est la bande de celluloïd, avec toutes ses imperfections matérielles, aqueuses à l’instar des images rémanentes de la rétine3.
-
Catherine Fowler, « Obscurity and Stillness: Potentiality in the Moving Image », Art Journal 72, no. 1, 2013, 65. ↩
-
Arthur C. Danto, « Moving Images », dans Andy Warhol, New Haven, Londres, Yale University Press, 79. [Il existe une traduction française par Laurent Bury publiée aux éditions les Belles lettres, Paris, 2011.] ↩
-
Zen for Film de Nam June Paik traduit cet aspect matériel du film par la projection d’une « pellicule nette, accumulant au fil du temps poussière et éraflures ». Voir Allen S. Weiss, « Some Notes on Conjuring Away Art: Radical Disruptions of Image and Text in Avant-Garde Film », L’Esprit Créateur 38, no. 4, 1998, 88. ↩
Dans le cinéma contemporain, la matière en mouvement du film a été remplacée par des procédés numériques qui inscrivent une nouvelle relation entre ce qui est animé sur l’écran et dans la technologie de la projection. Comme le souligne Jon Inge Faldalen, le traitement des données numériques code séparément l’immobilité et le mouvement. Ce n’est pas le cas du film ou de la vidéo, où le déroulement inéluctable de la bobine supplante la stabilité de l’image. Avec l’imagerie numérique, tandis qu’un carré de lumière qui change nécessite le calcul d’un nouvel ensemble de données, un pixel qui ne varie pas d’un instant à l’autre ne traite aucune nouvelle information. On peut l’observer avec l’écran de veille, conçu pour empêcher la fixation de pixels immuables sur l’écran. Faldalen fait remarquer que lorsqu’une ombre se déplace sur un rocher, seuls les bords changent; les parties sombres demeurent constantes jusqu’à ce qu’elles soient, elles aussi, envahies par la lumière1. Sur la surface de l’écran projeté numériquement, le pixel inaltéré correspond à ce point ombragé et immuable.
-
Jon Inge Faldalen, « Still Einstellung: Stillmoving Imagenesis », Discourse 35, no. 2, 2014, 235. ↩
Mercredi 14 avril 2021, heure de départ 17h02, de Lok Ma Chau
Shenzhen au-delà de la rivière Sham Chun. Au sud de cette frontière, des terres agricoles en jachère. Au nord, des tours alignées en une file qui semble uniforme s’étirent le long de l’horizon. Le bruit des moteurs de camions et le pépiement des véhicules en marche arrière signalent des travaux de terrassement. La lumière du début de soirée ne varie pas tellement; ses inflexions argentées aiguisent les profils angulaires et ouvrent des perspectives au loin. Depuis la base de la colline à moitié calcinée qui s’assombrit, une fumée ondulante s’échappe obliquement du sol.
Larry Gottheim a tourné Fog Line (1970) dans les environs de Binghamton dans l’État de New York. Le film s’ouvre sur un écran d’un gris uniforme strié de lignes horizontales et marqué d’une tache sombre. Cette abstraction se déplace et se retire pour faire apparaître un paysage bucolique; le vert de la colline apparaît comme une réaction chimique dans l’atmosphère. Le spécialiste du cinéma Scott MacDonald note : « Aucun événement dramatique ne se produit, il n’y a pas de chute.... Les ‘‘événements’’ sont subtils et, pour la plupart des novices, invisibles… »1. Une attention soutenue semble révéler deux « chevaux fantômes » sous des arbres au second plan, leurs silhouettes fournissant une échelle à ce qui n’était pas mesurable au départ2. Là où Empire de Warhol maintient une distance froide, Fog Line nous invite à observer le changement et à mesurer le mouvement par rapport à l’immobilité : ces choses qui apparaissent ou se révèlent par opposition à ce qui a toujours été là.
-
Scott MacDonald, « Ten (Alternative) Films and Videos on American Nature », Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 6, no. 1, 1999, 3. ↩
-
Larry Gottheim, « Fog Line (1970) », Larry Gottheim Films, https://www.larrygottheimfilms.com/descriptions. ↩
À propos de Double Tide (2009) de Sharon Lockhart (qui partage l’esthétique du mouvement et de l’immobilité de Fog Line), MacDonald pose la question suivante : « Combien de temps et avec quelle attention pouvez-vous regarder? » suggérant que « c’est un véritable défi qui semble de plus en plus radical dans un monde où les distractions ne cessent de s’accélérer » 1. L’installation à deux bandes de quatre-vingt-dix-neuf minutes de Lockhart suit le mouvement d’une pêcheuse de palourdes qui profite de la concomitance des marées basses à deux reprises au cours d’une même journée, au crépuscule et à l’aube. Alors que la pêcheuse poursuit sa tâche, elle s’éloigne de l’horizon, mais reste dans le cadre, suggérant une complicité chorégraphiée avec la cinéaste. Comme dans Fog Line, l’immobilité et le mouvement dépendent l’un de l’autre, de sorte que ce devenir se développe comme un présent contingent simultané au visionnage.
-
Scott MacDonald, « Cine-Surveillance: 3 Avant-Docs Interviews with Amie Siegel, Sharon Lockhart, Jane Gillooly », Film Quarterly 66, no. 4, 2013, 28. ↩
MacDonald décrit les films à plan fixe comme un « cinéma de la lenteur », mettant en avant leur relation au temps. Dans ses écrits sur les ombres, Faldalen les qualifie de stillmoving (« fixes-animées »), une catégorie qui repose sur le triple sens du mot anglais still : « un concept combinant sa signification spatiale adjectivale, qui ne bouge pas, et sa signification temporelle adverbiale, continu, ainsi que son agentivité affective au calme et à la tranquillité »1. Faldalen propose également que l’entre-deux qui caractérise la relation du plan fixe à la photographie constitue une autre sorte d’immobilité. Cette immobilité consiste à fixer un espace pour que la lenteur du temps puisse s’y manifester. Le triple sens du mot « still » est le fil conducteur de l’ambiguïté d’un cinéma qui se trouve à un seuil entre l’activité et la stase, et où cet état liminal permet d’ouvrir une autre possibilité d’être « calme et tranquille ».
L’immobilité des films à plan fixe instaure une relation spécifique au souvenir et à l’oubli qui diffère de nombreuses expériences cinématographiques. Sa continuité est telle que notre souvenir de ce qui s’est passé avant est latent. Nous sommes sensibles au passé à travers son immanence dans l’image présente. Pourtant, comme la mémoire elle-même, la certitude de ce qu’étaient les choses est obscurcie par ce qui est présent actuellement; le caractère immanent se traduit par une incertitude qui rend difficile toute lecture ou connaissance stable. Cette incertitude pose un doute sur la nature du devenir et exige une double action d’attentivité et d’ouverture. Le regard n’est pas dirigé vers un point prédéterminé du cadre, mais plutôt vers l’endroit où la personne qui regarde choisit de l’orienter. Le fait de regarder ou d’observer évolue en une vision dispersée sur le plan horizontal du cadre : une attention et une vigilance uniformément étirées qui cherchent des éraflures sur la surface. La connaissance est à la fois conviée et frustrée dans le champ de l’image qui change constamment bien que presque imperceptiblement.
Catherine Fowler affirme que ce processus de connaissance frustrée agit comme une incitation à l’attentivité visuelle. Le film à plan fixe s’éloigne de la réalité, pour atteindre ce qu’elle appelle une « potentialité ». La potentialité n’est pas fondée sur l’événement, mais plutôt sur un regard attentif, non orienté et uniforme qui confère puissance au temps et à l’espace2.
La potentialité fait écho aux conceptions de la ville qui mettent en avant l’urbain comme un ensemble de relations ouvertes plutôt que comme une mise en scène. Brian Massumi, à propos de sa collaboration avec l’artiste urbain multimédia Rafael Lozano-Hemmer, décrit la ville comme un « espace désormais défini autant par une surcharge de chemins potentiels pour la rencontre humaine qu’à travers ses propriétés géométriques et géographiques »3. Cet espace, ces chemins potentiels, font passer la ville du statut de « site » à celui d’« ensemble de relations », de sorte que les interventions ne sont plus « spécifiques au site, mais spécifiques aux relations »4. Les intersections tracées entre ces relations, qui décrivent les chemins des protagonistes humains et non humains, des architectures ainsi que de l’air, des roches et des animaux, constitue « un surplus de potentiel indéfini »5. Alors que la ville en tant que site est une toile de fond sur laquelle les choses se déroulent, la ville en tant que relations permet un autre type de perception dans la mesure où « la relation survient toujours… avant son prochain déroulement séquentiel »6. Ce développement continu de la structure relationnelle de la ville signifie que la perception doit rester réceptive et en phase. Le visuel devient l’une des nombreuses portes d’entrée vers la potentialité de la ville.
La potentialité figure le territoire de la ville non pas en tant qu’événement, mais plutôt un devenir spécifique aux relations. La ville apparaît comme un amalgame de trajectoires – de matières, de vies et de pratiques qui composent l’espace. Il s’agit d’une imagination qui résiste à la représentation de l’espace considéré comme inerte, contenu ou neutre, le présentant plutôt comme foisonnant et en mouvement : une circulation constante de trajectoires proches et lointaines qui génèrent des possibilités de reconfiguration. La géographe Doreen Massey affirme qu’une telle reconceptualisation de l’espace, qui met en avant des imaginaires spatiaux comme possible devenir, est nécessaire pour laisser le futur ouvert. Cette ouverture est, à son tour, la base du politique7.
-
Faldalen, « Still Einstellung », 235. ↩
-
Catherine Fowler, « Obscurity and Stillness: Potentiality in the Moving Image », Art Journal 72, no. 1, 2013, 65. ↩
-
Brian Massumi, « Urban Appointment: The Possible Rendez-Vous With the City, dans Making Art of Databases, Jake Brouwer et Arjen Mulder (dirs.), Rotterdam, V2 Organisatie/Dutch Architecture Institute, 2003, 2. ↩
-
Massumi, « Urban Appointment », 7–8. ↩
-
Massumi, « Urban Appointment », 9. ↩
-
Massumi, « Urban Appointment », 7–8. ↩
-
Doreen B. Massey, For Space, Londres, Sage, 2005. ↩
Mercredi 10 février 2021, heure de début 16h12, de Cecil’s Ride
De l’autre côté du port, des bâtiments tassés le long d’une bande de terre. Ils sont sans commune mesure avec les tours et les carrières à flanc de coteau qui s’élèvent derrière eux. Le tunnel de Cross-Harbour se déverse dans une étendue de béton, marquée par un barrage que forme de nombreuses cabines de péage. Des remorqueurs, des bateaux et des voiliers tracent des chemins qui seraient bien usés s’ils étaient sur la terre ferme. Un ferry fait l’aller-retour entre Kwun Tong et Wan Chai, à la lisière du cadre. Des sommets se dessinent dans le proche et le lointain. Certaines collines sont aussi hautes que des tours. Elles s’effacent et se révèlent telles des ombres obscurcies lorsque le soleil lui-même apparaît.
Cet article a été traduit de l’anglais par Gauthier Lesturgie.