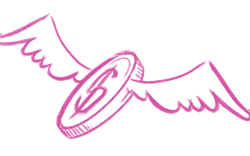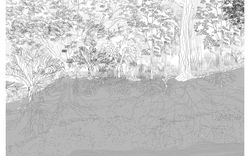Promesses ou inquiétudes
Cinq notes de terrain le long des routes canadiennes par Paul Nadeau et Laura Pannekoek
Clinton, une petite ville sans aéroport ni gare en Colombie-Britannique, a été fondée sur la piste de la ruée vers l’or de la région de Cariboo. Bien qu’elle subsiste aujourd’hui grâce aux revenus de la production locale de gravier, de l’élevage de bétail et du tourisme, la ville est truffée d’éléments iconographiques liés à la fièvre de l’or : façades de style « Old West », mannequins représentant des homesteaders [colons] et magasins d’antiquités regorgeant de casseroles et de pioches rouillées bordent l’unique route principale. On y trouve également un panneau Shell usé par les intempéries, abandonné de sa station-service, emblème de l’optimisme pétroculturel qui a succédé aux premières ambitions frénétiques de Clinton pour le précieux métal. Les projets d’extraction et les aspirations culturelles qui les accompagnent sont étroitement liés à la ville, comme en témoignent ses panneaux de signalisation.
Quelle est la fonction du panneau routier dans la compréhension et l’interprétation d’un lieu? Les signes comme ceux de l’image ci-dessus évoquent de multiples strates narratives coloniales associées à l’extraction et ses croyances économiques, tantôt en perte de vitesse, tantôt bien vivaces. Voici cinq notes de terrain prises lors d’un road trip entrepris en juillet 2021 entre Montréal et Victoria, qui racontent nos rencontres avec des panneaux routiers, ces documents destinés au public qui jalonnent le territoire à la fois sur le plan sémiotique et topographique. Certains de ces signes témoignent d’une orientation persistante des colons vers leur lieu, un attachement qui passe le plus souvent par un ensemble de liens affectifs avec une histoire réelle ou imaginée. Ces signes sont en contradiction avec d’autres qui, par exemple, soulignent les pratiques de subsistance des populations autochtones. D’autres encore tentent de réconcilier ces passés et ces présents au sein de nouveaux imaginaires conçus pour le tourisme. Considérer la signalisation routière en tant que dispositif territorial nous permet d’examiner certaines façons dont les territoires se font et se défont dans le contexte des pratiques d’extraction coloniale dans les régions rurales du Canada.
Prince Rupert est un port maritime situé sur la côte ouest, de la taille de celui de Vancouver, par lequel du bois, des céréales, du charbon et bien d’autres choses encore transitent par les terminaux. Pour s’y rendre par voie terrestre, il faut parcourir 150 km sans interruption depuis Terrace, en Colombie-Britannique, sur l’autoroute 16, entre les wagons de charbon d’un côté et le fleuve Skeena de l’autre. Ce trajet est long : c’est ici que la route prend fin et que, comme nous l’indique un panneau, « la contrée sauvage du Canada commence ».
L’affiche de gauche est fissurée, rongée par les effets du sel et du soleil : mouillage, séchage, craquelure et décoloration. Un pêcheur et une ouvrière de conserverie y figurent au premier plan. Ces deux personnages brandissent respectivement le saumon pêché et celui en conserve, la matière première et la marchandise conditionnée. Le panneau présente la nature sauvage canadienne comme un défi à relever, une invitation à pêcher, tuer et mettre en conserve. Le potentiel économique de l’océan s’exploite à travers la mise en conserve, le processus matériel de transformation ontologique de la créature vivante en marchandise : non périssable, transportable, exportable. Les conserveries de Prince Rupert marquaient la phase terminale de transformation du saumon du Pacifique : elles convertissaient des créatures vivantes en produits durables et mobiles.1 C’était une certaine époque, avant les années d’embruns marins, les populations de saumon du Pacifique subissent aujourd’hui un grave déclin.
De nos jours, Prince Rupert propose des circuits d’aventure, nous indique un panneau situé à proximité. Grizzlis, orques et baleines à bosse nous attendent, suscitant à la fois peur et émerveillement. Si l’économie de Prince Rupert au XXe siècle était centrée sur la pêche et la mise en conserve – l’emballage et l’exportation de la nature sauvage – celle du XXIe siècle consiste à vendre sur place le spectacle de la vie sauvage dans un environnement contrôlé . Le tourisme d’aventure tire profit du désir colonial : explorer l’inconnu et en prendre le contrôle.2
Cette paire de panneaux raconte l’histoire de la refonte économique de la côte occidentale. Le front d’exploitation des ressources naturelles du Pacifique – un territoire riche de fortes et vigoureuses populations de poissons et de fruits de mer – est lui-même reconditionné en territoires commercialisables pour l’expérience touristique. Raréfiée par la surpêche, la vie marine acquiert une nouvelle valeur en raison de sa rareté. L’océan appauvri est réévalué en tant que capital social, saisi par les touristes qui peuvent ainsi observer une baleine à l’état sauvage.
-
Jeff Diamanti entend par « terminal » ce qui « marque la fin physique et logique d’une chose et le début d’une autre, ainsi que l’abstraction qui relie les deux côtés de cette phase (ce qu’elle termine et ce dont elle est la source) ». Voir Jeff Diamanti, Climate and Capital in the Age of Petroleum: Locating Terminal Landscapes, Bloomsbury Publishing, Londres, 2021. ↩
-
Voir Robert Fletcher, Romancing the Wild: Cultural Dimensions of Ecotourism, Duke University Press, Durham, 2014, 113-129. ↩
« Le plus grand au monde » est un titre de gloire souvent invoqué dans le domaine des attractions de bordure de route. Ce superlatif invite les automobilistes à s’arrêter : il ne s’agit pas seulement d’une ville de passage, mais d’un lieu qui se réclame d’un patrimoine historique. Cobalt, dans l’Ontario, est un lieu de ce type, ou du moins c’est ce qu’imagine son poteau de revendication du territoire. Une vague de prospérité au début du XXe siècle a fait de cette ville l’épicentre de l’innovation en matière de technologie d’extraction de la roche massive. Les structures d’investissement nécessaires aux projets miniers à grande échelle ont contribué à l’essor du secteur bancaire de l’Ontario et de la bourse de Toronto. Une crise a rapidement suivi, puis un nouveau boom dans les années 1950. Aujourd’hui, Cobalt est devenu une destination touristique, « […] une communauté dynamique nichée au cœur du bouclier précambrien », peut-on lire sur le site officiel de la ville. La couleur locale promue par la municipalité est tellement liée à l’exploitation minière que son emplacement même est compris géologiquement (verticalement) plutôt que topographiquement (horizontalement).
Le poteau de revendication est un point de repère au sens premier du terme : il s’agit d’un marqueur de territoire, considérée comme une propriété. Une infrastructure coloniale de revendication qui sous-tend le discours, l’idéologie et la juridiction coloniale. En tant que dispositif architectural, le poteau participe à la construction active d’une relation de propriété et à la délimitation des frontières. Mais sa matérialité est surprenante. Tout ce dont on a besoin pour une revendication, c’est d’un signe, mais il s’agit ici d’un poteau fabriqué à partir d’un arbre. Si la personne cherchait simplement à revendiquer sa propriété, pourquoi cet arbre a-t-il été abattu avant d’être replanté? Quand un arbre est coupé pour être réutilisé comme symbole de la propriété, une transformation s’opère : de l’écologie à la propriété, de la terre au territoire, du bois à la performance du pouvoir.
Quelle est aujourd’hui la fonction du poste de revendication? Cobalt n’est plus une frontière de prospection, mais une marchandisation de l’identité de cette frontière. Son poteau de revendication est un monument aux idées sur la terre et la propriété qui se sont imposées aux dépens des peuples et des écosystèmes autochtones, au prix d’actes de violence à leur encontre. Le passage de Cobalt de l’exploitation minière au tourisme ne change rien à la logique et aux principes coloniaux qui ont présidé à la fondation de la ville et à son essor au début du vingtième siècle. Le poteau situé en bordure de route témoigne de l’idéologie coloniale persistante au Canada, même si les économies locales et nationales changent de forme.
L’intersection de l’autoroute 16 et de la route de l’Alaska est un carrefour à plus d’un titre. Un appel à « dire non au forage de gaz de houille dans les Sacred Headwaters » entre en collision avec le panneau de signalisation routière, l’occultant partiellement. Pourtant, ni l’Alaska ni les Sacred Headwaters ne se trouvent à proximité de cet endroit ; les distances et les préoccupations sont réduites, condensées et concentrées à cette intersection. Le carrefour marque un terrain contesté qui mérite qu’on s’y attarde. Aucun des deux panneaux ne peut être appréhendé sans l’autre.
La pancarte indiquant la présence de gaz de houille date de quelques années : la surface en contreplaqué sur laquelle il est apposé est visible à travers la peinture écaillée. Le fait qu’il y ait des personnes qui défendent le saumon sauvage suggère la reconnaissance d’une relation symbiotique. Ces poissons continuent de se reproduire et d’être capturés, et nous veillons à ce que les rivières et les océans restent vivables. Mais ce « nous » est particulier. Les fleuves Skeena, Nass et Stikine s’écoulent tous depuis les Sacred Headwaters, dans un bassin hydrographique d’une importance cruciale pour la nation Tahltan.1 Étant à proximité du site où les organisations de défense des terres Wet’suwet’en continuent de bloquer le gazoduc Coastal GasLink, nous prenons un moment pour réfléchir avec Anne Spice. Sommes-nous peut-être ici face à la véritable signification du terme « infrastructure critique » : non seulement les gazoducs et les raffineries, mais aussi les écosystèmes et les formes de vie qui soutiennent les existences, les moyens de subsistance et les modes de vie de ce territoire?.2 L’argument contre le forage est lié au droit des autochtones de pêcher et de vivre. Bien que le forage ne soit plus en cours et que des mesures de protection aient été mises en place, cette victoire signifie-t-elle qu’il est temps de démanteler cette pancarte?3 Ou devrions-nous la laisser en place pour rappeler que ce site est un territoire contesté?
-
Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles, Nation Tahltan, « Protecting the Sacred Headwaters of the Klappan Valley », communiqué de presse, 27 août 2019, https://tahltan.org/press-release-protecting-the-sacred-headwaters-of-the-klappan-valley/. ↩
-
Anne Spice, « Fighting Invasive Infrastructure: Indigenous Relations against Pipelines », Environment and Society: Advances in Research 9, 2018, 40-56. ↩
-
« Oil, Gas Development Banned in B.C.’s Sacred Headwaters », CBC News, 18 décembre 2012, https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/oil-gas- development-banned-in-b-c-s-sacred-headwaters-1.1283417. ↩
À Kitimat, terminus du Coastal GasLink, LNG Canada est en train d’ériger un énorme terminal d’exportation pour le gaz naturel liquéfié extrait au nord de la Colombie-Britannique. Le gazoduc reliant le port aux gisements de gaz continue d’être objecté et bloqué par les groupes Wet’suwet’en de défense des terres. Kitimat, comme Prince Rupert, dispose d’eaux particulièrement profondes à proximité du rivage, ce qui le rend parfaitement adapté aux terminaux de navigation en eau profonde : c’est pour cette raison que ce site situé à l’extrémité du canal Douglas, sur les terres de la nation Haisla, a été choisi depuis les années 1950 pour le développement de plusieurs projets liés à l’énergie, parmi lesquels une scierie, différents gazoducs et des installations d’exportation.
La construction par la société d’aluminium Alcan d’une fonderie, d’un barrage et de la ville de Kitimat, appelée simplement « le projet », était autrefois le plus grand plan d’infrastructure du Canada qui devait donner naissance à une ville d’une population de 50 000 personnes.1 Soixante-dix années oscillantes entre croissance et récession ont eu raison de la ville, qui ne s’est jamais développée. Lors de la construction de la fonderie et du barrage dans les années 1950, 8 000 emplois ont été promis ; moins de la moitié se sont concrétisés. Le nouveau terminal GNL ravive toutefois cet optimisme. Le matin, à notre campement près de la rivière, un homme est arrivé en camion, peut-être pour profiter de la vue, ou pour pêcher. Il nous a raconté qu’il travaillait auparavant à la fonderie après être arrivé à Kitimat dans les années 1960 et y rester jusqu’à aujourd’hui. Il nous a parlé du terminal GNL : « On y construit des logements temporaires pour 8 000 personnes qui travaillent dans l’industrie, ce qui représente la population totale de la ville. »
Le long de la rive ouest de la baie se trouve la route Alcan, nommée d’après la société qu’elle dessert. Nous l’avons empruntée jusqu’à cette scène à Hospital Beach, qui offre une vue sur l’aluminerie et l’installation d’exportation Coastal GasLink en cours de construction. Devant, une pancarte usée par les intempéries, à la fois informative et désespérée, nous sollicite : « Merci de prendre soin de cette ressource ». En réfléchissant à nouveau avec Diamanti, nous considérons ce paysage comme un terminus, où des choses sont transformées en d’autres choses, où des matériaux quittent un contexte physique pour entrer dans le monde abstrait de la logistique avant d’être transformés à nouveau dans un autre terminal, loin de celui-ci. Merci de préserver et de respecter l’habitat du littoral, dont les cycles d’expansion et de ralentissement se heurtent à la liminalité du terminus. Merci de permettre au régime d’extraction de parvenir enfin à une sorte de conclusion, de terminus vers un purgatoire entre le déclin et la promesse.
-
Walter Thorne, « Kitimat: A Century of Boom and Bust », The Northern Sentinel, 1 décembre 2018. ↩